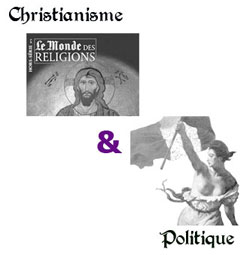
On peut distinguer deux courants dans le christianisme : d'un côté un christianisme libéral qui considère que la religion est du domaine privé, de l'individu et n'a donc pas à intervenir dans le domaine politique ; de l'autre un catholicisme social qui défend une politique sociale respectueuse des citoyens sur les principes des enseignements de l'Eglise. Au sein du Christianisme, il y a donc deux mouvements : un mouvement où la religion est privée et un autre où la religion peut influencer la politique.
Il s'agit d'un courant politique de droite modérée qui est apparu
vers la fin du XIXe siècle en Europe. Il défend l'idée que
le pouvoir doit s'inspirer des valeurs véhiculées par l'Eglise :
le respect de l'être humain, les droits de l'homme, la fraternité,
l'aide aux plus démunis. Concrètement, les démocrates-chrétiens
placent l'homme au centre des préoccupations et considèrent que
l'Etat doit conserver un pouvoir d'intervention dans la société,
notamment dans l'économie.
En Allemagne, la Démocratie chrétienne domine la droite avec le
parti de la CDU (Union chrétienne démocrate d'Allemagne). Si les
références chrétiennes demeurent, le parti sous l'impulsion
d'Angela Merkel, a pris un tournant plus libéral économiquement.
Contrairement à l'Allemagne, il n'y a jamais eu en France un grand parti
démocrate-chrétien en raison de la diversité des sensibilités
démocrates-chrétiennes : il y avait des démocrates-chrétiens
de gauche et des démocrates-chrétiens de droite. Sous la IVe République,
c'est le MRP (Mouvement Républicain Populaire) qui se revendique de la
démocratie chrétienne. Acteur essentiel de la IVe République,
il perd de son influence avec l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en 1958.
A partir de cette date, les partisans de la démocratie chrétienne
se sont dispersés et une partie d'entre eux ont rejoint le centre incarné
par Jean Lecanuet. Le parti centre démocrate, où l'on retrouve des
démocrates chrétiens, rejoint l'UDF en 1978. Aujourd'hui, François
Bayrou se revendique en partie de cette démocratie chrétienne.
Il y a toujours eu France des réticences à immiscer la religion
dans la politique. Depuis la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise
et de l'Etat, les hommes politiques sont plus enclin à parler de laïcité
que de religion. Aujourd'hui, certains catholiques traditionnalistes soutiennent
le Front national, Philippe de Villiers défend volontiers ces valeurs chrétiennes.
Quant à François Bayrou, fervent catholique, il revendique toujours
le passé démocrate-chrétien de l'UDF même s'il prend
soin de séparer toujours ses convictions politiques et de ses convictions
religieuses.
Avec l'Extrême droite, Nicolas Sarkozy est le seul à insister
sur ses convictions chrétiennes. En 2004, il a écrit un livre
dans lequel il parlait de ses convictions religieuses. Dans son discours d'investiture
du 14 janvier 2007, le candidat de l'UMP a fait référence au christianisme
en déclarant : "Nous sommes les héritiers de deux mille ans
de chrétienté et d'un patrimoine de valeurs spirituelles que la
morale laïque a incorporé. (...) Opposer le sentiment religieux
à la morale laïque serait absurde". Le lendemain, son premier
déplacement en tant que candidat officiel à l'élection
présidentielle est effectué au Mont Saint Michel dans le but de
célébrer "la spiritualité et le travail des hommes".
Alors que François Bayrou se montre plutôt discret sur ses convictions
religieuses tout comme Ségolène Royal qui est issue d'une famille
catholique, Nicolas Sarkozy semble en faire un argument de campagne afin d'attirer
à lui un électorat catholique quitte à jeter le trouble
chez les défenseurs de la laïcité.